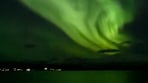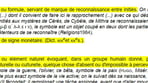La Vague
Rencontre sur le GR5


La vague
Hokusai sur le GR5
Elle était de nouveau devant mes yeux, un peu plus bas pour elle, un peu plus haut pour moi. Elle avait attiré mon regard sur le chemin depuis le col de Golèse. La descente n’étant pas abusivement raide ni jonchée de ces cailloux roulants sous les semelles, j’avais pu fixer mon regard régulièrement vers elle et plus je regardais plus elle me questionnait, me fascinait, et me perdait. Quand nous nous sommes installés près de la cabane forestière, une trouée claire dans les sapins, elle était là, bien en face, dans l’échancrure verte des branches. Il était tôt pour une fois, nous allions avoir le reste de l’après-midi pour nous reposer, et rester là tranquillement, jusqu’au lendemain. Les données météo annonçaient de très fortes pluies et de l’orage en fin de journée d’où l’idée de s’arrêter dès maintenant afin de ne pas se retrouver en train de marcher sous un déluge.
Quand les muscles se sont détendus, que l’estomac s’est rempli, que les discussions se sont peu à peu évanouies, vient ce flottement, un imperceptible ennui. Il n’y a plus d’autre but à atteindre que la venue du soir, le repli dans le cocon de notre tente grise et ses émanations légères d’humidité, puis la nuit lente et longue. Le soleil est encore bien haut, je n’attends rien, je reste en suspension entre deux états, le vertical de la marche, l’horizontal du sommeil. On pourrait faire des récits de montagne uniquement par les postures, de nos corps et du sien : je suis assise et la vague s’élance derrière les couronnes de résineux, discrète et puissante. Loin d’être un panorama, notre emplacement est au contraire caché à la lisière du bois, légèrement en surplomb de la cabane. C’est un replat juste assez grand pour nous, d’où s’échappe un sentier sauvage sûrement fréquenté par les animaux qui descendent boire à la rivière coulant en contrebas.
Le sommet de la montagne est constitué de petites barres rocheuses bien alignées, à la crête vert tendre, s’étageant comme de grandes marches d’escaliers bosselées, fissurées. Je compte trois marches et sur la gauche, une immense masse se redresse et vient se cogner dans la muraille, avec fougue. Par plis et feuilletage, la vague s’enroule alors puissamment tout en formant un second rouleau, une spirale à ses pieds. A partir de là c’est un cirque totalement instable, un chaos blanc et vert, que je vois tantôt plateau, tantôt gouffre, toute notion de verticalité ou d’horizontalité est brouillée : un mystère impossible à résoudre. En descendant le col j’avais aperçu des formes en creux, comme si on avait découpé des pièces de puzzle dans l’épaisseur calcaire. On pouvait déjà soupçonner cet enroulement colossal, sans tout à fait le comprendre. Ici, c’est en plein centre de ma vision, pourtant rétrécie au fin fond d’une clairière, encadrée par des rideaux d’arbres bien serrés, que la vague se montre avec panache. Elle gronde et s’abat dans le fracas géologique, sons de millions d’années d’ondoiement terrestre. Si j’avais un livre ou un professeur de géologie à mes côtés il pourrait m’expliquer avec précision les plis, les compressions et l’histoire sédimentaire de ce pan de montagne, il me parlerait d’anticlinal ou de Cénozoïque, et ce serait passionnant. Passionnant et toujours autant déconcertant. Car si j’aime de tout mon cœur le vocabulaire scientifique, qui me fait penser à des débuts de conte fabuleux, il a souvent pour effet de maintenir la distance entre la montagne et moi. Tandis que je voudrais faire battre nos cœurs ensemble, les termes savants, aussi beaux soient-ils, sont porteurs d’une froideur : on ne badine pas avec un lapiaz, avec le métamorphisme ou le Cénozoïque ! Ce sont là choses « sérieuses ». Rigoureuses. Qu’il faut apprendre longtemps pour pouvoir les utiliser. Je n’ai, de toute façon, ni livre ni professeur et même si je pourrais fouiller dans mon smartphone pour comprendre comment la vague fut créé, récoltant quantité d’informations naturalistes sur la formation des Alpes, je préfère pour l’instant me contenter de l’intuition. De la sensation. Car il y a autre chose, à ce moment-là, qui se déploie. La quête de nos intimités mêlées. La rencontre.
Je cherche à entrer dans la vague. Je crois distinguer des zones de grands vents, des fentes, des ombres abyssales, là encore je n’ai ni jumelles ni zoom d’appareil photo, mais que deux yeux un peu faiblards pourtant si désireux de voir qu’ils se mettent à dessiner par eux-mêmes, les lignes de la roche. Fatiguée de scruter et du poids de la vague sur mon cou, je pose mon regard dans l’herbe près de moi, quelques instants. Une petite campanule bleue en clochette vient alléger la présence minérale. Mais cela ne dure pas, car la vague m’appelle encore. A lever les yeux. A plonger.
Ça bouillonne de temporalités multiples.
Le calcaire s’amuse à me parler de mes histoires, mes images : la forme est exactement celle de la grande vague de Kanagawa, la fameuse estampe japonaise d’Hokusai, dont les reproductions abondent dans de nombreuses décorations intérieures de restaurants et de foyers, une image figée par l’usage mais si vive encore. Les traits de cet art du Japon, le monde flottant, viennent se superposer au grand remous alpin, avec tant de véracité. La force ahurissante du tsunami dans l’encre subtile, la violence inouïe du plissement des roches dans un silence paisible.
Ma vague (puisque nous nous appartenons un petit peu désormais), me tend ses bras d’écume fossile, sa rugosité de vieille roche coupante, raclée, m’invite à danser.
La montagne et la mer dansent, elles dansent comme l’eau qui coule et traverse, et transperce. L’océan alpin n’a jamais disparu puisque le voici plus vivant que jamais, sa chorégraphie vient s’intégrer à mon propre rythme d’humaine. Je suis moi-même flottante entre les sapins, brassant l’air de mes mains, écoutant l’eau qui coule en moi, flux ouvert, poreux, corps ouvert aux mouvements de la Terre. Sans savoir vraiment. Sans analyser pourquoi, mais en savourant les traces, je peux, à cet instant, me raconter avec la vague. Sans fusionner ni disparaître, être en prise avec elle. Ce n’est qu’un fragment, une portion de montagne, un paysage cadré, pourtant je peux la sentir tout entière. Mouvante. Sans arrêt. Je m’enroule avec elle. La géologie comme une poésie du soi ouvert. En lien.
Le coup de vent frais vient chasser ma danse alpine. La pluie s’approche. Une autre eau, plus jeune et furieuse, va s’abattre sur nos têtes.
Le calcaire célèbre l’abolition des clôtures, les passages de l’eau, de l’air, de la vie et de la mort qui se mêlent. Car tout vit encore, tout se meut et rien ne meurt comme la Finitude promise. Le calcaire vient me dire que je peux vivre avec lui, avec la Terre, et mêler mes rêves d’humaine aux cycles des montagnes. Un jour, elles s’aplaniront. Mourront. Mais leur mort dans le mouvement du cycle, libère mes angoisses d’Apocalypse.
L’orage est là. Pluie torrentielle. Aveuglement d’éclairs. Déchirure.
Blottie dans la tente je redeviens l’animale, le campagnol apeuré qui se terre en tremblant, et cherche la chaleur de son compagnon pour se réconforter. J’attends vraiment cette fois, j’attends que le jour revienne.
Le calcaire des montagnes a encore tellement de choses à raconter, j’ai encore tellement de choses à lui dire.
Je crois que oui, on peut badiner avec un lapiaz
Valser avec le Cénozoïque
Et s’aimer avec les vagues.